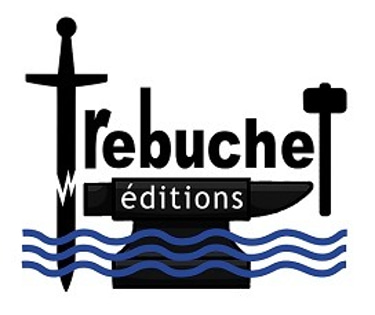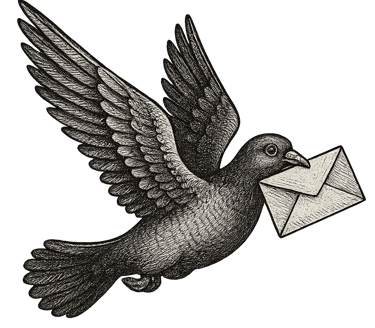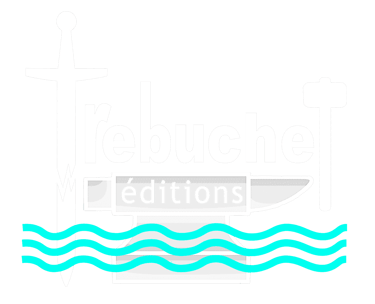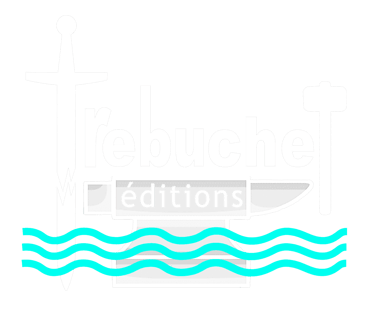La rose comme prétexte à une envolée philosophique
(de comptoir)
Simon Lalu
9/10/2023


Johann Scheffler (Angelus Silesius), gravure de 1892
La rose comme prétexte à une envolée philosophique
de comptoir
Au 17ème siècle, Angélus Silesius écrit :
« La rose est sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, elle ne se soucie pas d'elle-même,
elle ne se demande pas si on la voit. »
« La rose est sans pourquoi »...
Un siècle plus tard, son compatriote Johann Wolfgang Von Goethe élague cette pensée innovante en criant à la face du monde :
« Je vous en prie, ne cherchez rien derrière les phénomènes, ils constituent leurs propres leçons. »
Cette intuition est une percée inédite dans les champs métaphysiques, gérés depuis des millénaires par les religions.
Quand Abélard tentait de rationaliser les extravagances de la Bible, il le faisait en logicien, mais Goethe et Silesius sont d'authentiques mystiques. Ils préparent un terreau propice à engendrer le dernier mystique, allemand de nouveau, qui rendra tous les autres impossibles. Nietzsche achève Dieu, nous indique comment se débarrasser de son cadavre et nous enseigne que nous pouvons vivre sans lui, et même mieux. Mais à nous de faire le travail !
Le traumatisme est vibrant dans la pensée ambiante. En France, Albert Camus nous offrira l'anti-dépresseur tant attendu en écrivant Le mythe de Sisyphe. Le monde est absurde et n'a aucun sens certes, mais ce n'est pas grave. Cela ne nous empêche pas de vivre, et d'ailleurs, nous n'avons aucun rôle précis à jouer, alors jouissons et créons car nous sommes aux manettes de notre existence, même si nous perdons en marge de manœuvre pendant les turbulences. Sacré Albert, qui arrive tout de même à nous déculpabiliser de toutes nos introspections existentialistes.
En attendant, de ce nouveau labour, de ce nouveau fumier plutôt, une nouvelle rose va éclore, sur une toute petite planète, l'astéroïde B612. Elle va charmer un Petit Prince et une humanité toute nouvellement disposée. Eternel Antoine de Saint-Exupéry, merci ! Même si aujourd'hui, ta fleur capricieuse et râleuse éclipse la rose immuable de Silesius dans l'imagerie populaire.
A noter qu'à l'époque de Goethe, une rose qui parle ne peut être considérée comme autre chose que démoniaque. Ce n'est plus le cas à présent (mais les fleurs chantent-elles toujours ?). Nous avons obtenu en échange le droit de nous rêver nous-même. A travers les conversations d'un Petit Prince et de sa rose (ou celles d'un enfant avec son tigre en peluche pour évoquer ici Calvin et Hobbes).
Il était légitime de vouloir comprendre le monde qui nous entoure. Nous savons aujourd'hui qu'il est inaccessible. Nous ne pouvons traiter qu'avec nos sens limités les interprétations que nous nous faisons de lui. Nous ne pouvons nous détacher de nous-même et ne parvenons qu'à nous observer en train de l'observer pour tenter d'apercevoir, dans ce jeu de miroirs, une image reconstituée de lui « le monde », la « réalité».
Devant ce constat vertigineux, la tentation de brandir la pancarte de Mark Twain est forte :
« Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » ou plutôt celle-ci « Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. ». De toute manière, je ne vois pas comment s'arrêterait cette quête effrénée de la compréhension du monde.
Les humains sont généralement insatisfaits, inadaptables et s'ennuient quand ils ne sont ni l'un ni l'autre. Ils continueront donc, ne serait-ce que par ennui, à multiplier les façons de définir le monde. Comme pour changer de maison et trouver un endroit où les roses semblent différentes.
Mais du temps de Goethe déjà, Novalis, un autre allemand (qui ne fêta jamais ses trente ans), avait tout dit :
« Tout est magie, ou rien. » Ou encore :
« Une fleur est un être entièrement poétique. » Nous voilà bien avancé.


Roses - vers 1880 - George Dunlop Leslie
Simon Lalu
Toute reproduction totale ou partielle de ce texte doit faire mention de la source et de l’auteur, merci !